Gui Patin est né à La Place près de Hodenc-en-Bray dans l'Oise. Après avoir commencé son éducation avec son père qui lui fit lire alors qu'il était, « encore tout petit » les "Vies parallèles" de Plutarque. Arrivé à Paris, il fit ses humanités au collège de Beauvais avant d'étudier la philosophie au collège de Boncourt. Refusant d'entrer dans les ordres, il se fâcha avec sa famille qui lui coupa les vivres et il dut alors se résoudre à prendre un emploi de correcteur d'imprimerie pour payer ses études de médecine.
En 1627, après avoir obtenu son bonnet de docteur, Patin se lia d'amitié avec Gabriel Naudé, l'un des médecins les plus érudits de l'époque mais aussi avec Gassendi. L'année suivante, Harvey ayant publié à Francfort son ouvrage en dix sept chapitres sur la circulation du sang, Patin s'éleva haut et fort contre ces théories fumeuses, traitant le médecin anglais de "circulateur". Habile avec les mots, Patin jouait ainsi sur le sens du mot latin "circulator" qui signifie "charlatan."
Médecin médiocre mais épistolier de talent
Il faut bien dire que Patin était bien peu avant-gardiste, adepte des bonnes vieilles méthodes comme la saignée et opposé aux drogues, aux traitement chimiques, aux purges et aux vins émétiques, écrivant ainsi : « les pharmaciens de vos quartiers mentent aussi impudemment que les nostres, afin de debiter leurs drogues. Voici la verité du vin emetique, afin qu'ils n'en facent acroire à personne. »
Il était dans la droite ligne des médecins formés à cette époque par la Faculté de Paris, très en retard sur ses homologues anglaises, allemandes ou hollandaises plus enclines à se tourner vers les nouvelles connaissances médicales. Bordeu écrivait ainsi sur la Faculté de Paris au milieu du XVIIe siècle : "Ce n'est point un endroit où l'on apprend; il faut avoir fait ses provisions avant d'arriver; c'est là qu'on se polit et qu'on acquiert cet air de suffisance et d'impertinence même, qui est nécessaire. "
Comme son maître, le "très-docte, très-expert et très-illustre Riolan, Prince des anatomistes", Gui Patin continua donc à défendre toute sa vie les théories des anciens et les vieux dogmes, s'élevant contre tous les nouveaux expérimentateurs dans ses Lettres. Médecin médiocre, Patin est surtout passé à la postérité pour avoir été un épistolier redoutable, critique acerbe, satiriste de talent et doué pour les bons mots.
Dans la correspondance qu'il a entretenu pendant plusieurs décennies avec les principaux savants de l’Europe, Patin dans, un style léger et sarcastique leur fait part des dernières nouvelles, de détails curieux sur la littérature ou de potins sur les hommes illustres, qu'ils soient médecins ou grands de ce monde. « Gui Patin, écrit ainsi Vigneul-Marville, était satirique depuis la tête jusqu’aux pieds… Son chapeau, son collet, son manteau, son pourpoint, ses chausses, ses bottines, tout cela faisait nargue à la mode et le procès a la vanité. Il avait dans le visage l’air de Cicéron, et dans l’esprit le caractère de Rabelais. »
Sa correspondance avec le médecin lyonnais Charles Spon brossent un intéressant tableau de la vie médicale à Paris et de la Faculté de médecine dont Guy Patin fut nommé doyen en 1650, riches de mille enseignements et anecdotes sur la manière dont était pratiquée alors la médecine à Paris et en Province .
Vingt ans après la mort de Guy Patin, on publia un recueil de ses Lettres écrites entre 1645 et 1672. On y trouve ainsi sa maxime restée célèbre : "tandis que les médecins se contredisent, les malades meurent!" . Patin y montre une grande verve, malheureusement souvent tournée vers tout ce qui pourrait contribuer à de nouveaux progrès médicaux, détracteur acharné du laudanum et des opiacés en général, du quinquina, des nouvelles médications chimiques comme l'antimoine, des eaux minérales et des cures thermales...

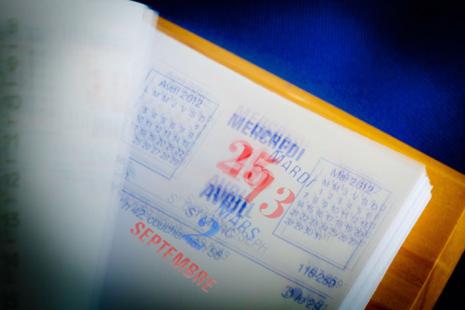
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature